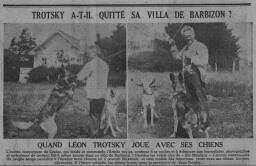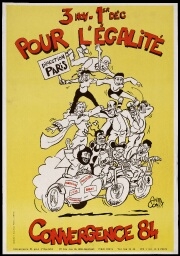2012
Le colloque européen «Patrimoine de l'immigrationen France et en Europe : enjeu social et culturel» fut organisé par l'association Génériques à la maison de l'Europe à Paris les 11 et 12 décembre 2012. Ce colloque avait pour objectif de développer la connaissance sur le patrimoine de l'immigration et d'interroger et de croiser les pratiques de ceux et celles qui y travaillent au niveau local, national, transnational et européen. Il avait également pour objectif de contribuer à définir l'état des recherches sur les enjeux du patrimoine de l'immigration et sur la place de l'immigration dans les politiques de patrimonialisation en France et en Europe.
Les communications présentées lors de ce colloque ont mis en exergue les enjeux importants autour de la question de la place de l'immigration dans le patrimoine national. En effet, alors que l'immigration est longtemps restée inscrite dans une invisibilité liée à une certaine conception d'une immigration dite « de travail » dans laquelle était occultée la dimension humaine, culturelle, sociale, affective & des immigrés, l'immigration en France a, depuis quelques années, acquis une certaine reconnaissance patrimoniale. L'idée que le patrimoine national comporte aussi des éléments liés aux apports culturels et identitaires de populations venues d'ailleurs paraît aujourd'hui acquise, même s'il faut reconnaître que de nombreuses questions demeurent ouvertes.
Qu'est ce qui se transmet dans l'immigration ? Qu'est-ce qui se transmet de l'immigration ? Comment émerge la conscience de l'existence de ce patrimoine ? De quelle nature sont les lieux de la transmission : familiaux ? Éducatifs ? Est-ce de cette transmission que naît le patrimoine ? Ou alors la patrimonialisation relève aussi de l'action d'autres acteurs, d'autres enjeux autour de la transmission de ces héritages ? Mais alors comment, par qui et surtout, pourquoi et pour qui, puisqu'aussi bien l'histoire de l'immigration ne saurait être écrite pour (et par) les seuls descendants d'immigrés ? Est-ce parce que le patrimoine de l'immigration peut être facteur d'intégration dynamique et de cohésion sociale ? Quelle histoire le patrimoine de l'immigration raconte-t-il ? Ou à l'inverse, quelle histoire se raconte (et se légitime) à travers lui ? De quelle manière, pour qui et pourquoi ? Quel rapport la mémoire, qui, depuis les années 1980, a investi le champ historique et l'espace public, a-t-elle avec le patrimoine, et quel rapport celui-ci entretient-il avec la mémoire et l'histoire ?
Toutes ces questions et les enjeux qu'elles révèlent étaient au cœur des discussions de ce colloque qui a rassemblé près de 30 spécialistes du patrimoine et de l'immigration: acteurs associatifs et culturels, pouvoirs publics, institutions patrimoniales, universitaires... provenant de pays divers (France, Belgique, Luxembourg, Grande-Bretagne, Suisse, Maroc, Algérie et Etats-Unis).
L'ensemble des présentations ainsi que des extraits des tables rondes et échanges avec le public qui suivaient les présentations sont mis en ligne dans cet inventaire.